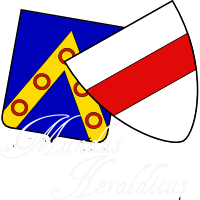
Dictionnaires des termes du blason - Rietstap
Planche 7
Dictionnaire | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y
Planche 1 | Planche 2 | Planche 3 | Planche 4 | Planche 5 | Planche 6 | Planche 7 |

Cette planche a pour but de donner un léger aperçu
des traits caractéristiques qui distinguèrent l'art héraldique au moyen-âge. Nous n'avons pu
qu'effleurer un si vaste sujet, mais nous aimons à croire que
ces quelques exemples suffiront pour appeler l'attention des amateurs sur un genre d'études, à la fois
artistique et archéologique, où ils trouveront autant
d'agrément que d'instruction.
Les fig. 1—8 donnent quelques beaux spécimens du
diapré, que l'on rencontre surtout dans les sceaux.
Les anciens artistes ne souffraient pas les espaces
vide ni dans l'écu, ni au-dehors. et s'efforçaient à
les diversifier par des feuillages, des rosettes, des lignes en sens divers, dont le choix était arbitraire et
dépendait du goût. Cette ornementation n'avant aucune valeur réelle, pouvait être changée d'un moment
à l'autre, et comme elle ne formait pas une partie
intégrante des armes, elle pouvait être négligée tout-
à-fait. Dans les représentations coloriées, ce diapré
était exécuté dans la même couleur que le fond sur
lequel il était appliqué, mais afin de le faire ressor-
tir les nuances différaient; le diapré était d'une teinte
plus claire sur un fond plus foncé ou plus foncée sur
un fond plus clair.
L'écu n°1 contient une simple bande et le n° 2 une
simple croix; le champ est diapré. Le n° 3 représente les armes de la famille anglaise de Vere,
qui consistent en un simple écartelé, chargé d'une
étoile dans le premier quartier. Chaque quartier est
diapré de la manière la plus compliquée, mais il
mérite l'attention des curieux que les quartiers du
même émail sont également distingués par la même
sorte de diapré. L'écu est écartelé de gueules et
d'or, et l'on voit que les deux quartiers de gueules
diffèrent par leur diapré des deux quartiers d'or. Le
n°4 est un écu coupé, dont chaque moitié nous
montre un diapré en forme de branchages. On remarquera en même temps que le contour de
l'écusson accuse les temps de la Renaissance. Le n°5
offre encore un des plus beaux spécimens du diapré; c'est l'écusson échiqueté de la famille anglaise
de Warren, où chaque carreau est devenu un petit
chef d'oeuvre de patience de la part de l'artiste. Le
n°6 figure les armoiries de la même famille, diaprées d'une tout autre manière. Enfin, dans les
n°7 et 8 l'artiste s'est borné à la décoration de la bande
et des deux fasces, sans s'occuper du champ. Cette
circonstance nous donne la preuve que ces écus datent d'un temps relativement moderne.
Viennent ensuite quelques échantillons de lions. Le
premier et plus ancien porte le pied dextre levé d'une
manière qui semble peu naturelle, mais qui était la
conséquence forcée de la forme triangulaire des écus
aux temps chevaleresques, qui n'avaient à leur base
pas assez d'espace pour que les pieds du lion pus-
sent s'y trouver à leur aise. A mesure que les écus
perdent cette forme et s'élargissent à leur base, ce
pied va toujours s'abaissant,jusqu'à ce qu'il se trouve
sur la même ligne que l'autre pied, parce que l'écu,
arrondi en bas, en fournit l'occasion.
Aux premiers temps de l'art héraldique, les lions n'avaient pas de langue et le bouquet de leur queue
était tourné en dedans. Plus tard, ils recurent une
langue et la queue était tournée en dehors, mais les
ongles restaient toujours saillantes.
Le premier lion, n°9, date de la seconde moitié du 12e
siècle et se trouve sur un bas relief en pierre, provenant du ci-devant couvent de Steingaden et
conservé au musée de Munich. Son corps est couvert
de poils bouclés. Dans la sculpture, il est placé
dans un écusson triangulaire, et la règle ancienne
que le meuble doit remplir autant que possible le
champ de l'écu, sans laisser d'espace de quelque im-
portance, y est trop bien observé, car les ongles de
la patte senestre et du pied senestre dépassent le
contour de l'écu et s'étendent au-dehors.
Le n°10 est une représentation du lion de la maison
de Hesse sur l'écu original du landgrave Henri de
Thuringe (mort en 1298), suspendu dans l'église
Sainte-Elisabeth, à Marburg.
Le lion du n°11 se trouve sur un vitrail de l'hôtel de
ville à Wasserburg sur l'Inn, en Bavière, dont il
est le blason, et date de la première moitié du 14e
siècle. Quoiqu'il porte encore le caractère du style
moyen-âge, il commence à s'approcher du type des
temps modernes.
Le quatrième lion, n°12, est représenté sur une feuille
d'un armorial hollandais portant le millésime 1542,
qui, il y a peu d'années, a été sauvé de la destruction par M. J.-C. van der Muelen, à la Haye. Par
ses ongles fortement accusées et sa queue tournée en
dedans, il fournit la preuve que, au milieu du 16e
siècle, les anciennes traditions héraldiques n'étaient
pas encore tombées en oubli, mais retenaient au contraire toute leur force.
Les aigles n'ont pas subi moins de variations de forme
que les lions. Comme ceux-ci, ils étaient dans l'origine
privés de langue et avaient une attitude contrainte,
qui était la conséquence de la forme triangulaire des écus. Les pattes se dirigeaient presque
perpendiculairement en bas et les ailes étaient tou-
jours abaissées, parceque les dimensions de l'écu
ne permettaient pas de les éployer.
La première aigle, n°13, est empruntée à un sceau du
comte palatin Otton de Wittelsbach, attaché à une
charte de l'an 1207, conservée aux archives d'état
à Munich. Par rapport à la date, la deuxième aigle,
n°14, d'un type différent pour ce qui regarde les
ailes et la queue, est contemporaine, car elle se
trouve sur un sceau d'un comte d'Arnsberg de l'an
1208, conservé aux mêmes archives.
L'aigle, n°15, du commencement du 16e siècle, représentée sur le monument d'un abbé de Saint-Alban,
à Londres, offre un exemple remarquable de la liberté
que les anciens artistes pratiquaient en exécutant des armoiries et du savoir-faire dont ils firent
preuve en se conformant aux exigences de lieu et
d'espace. L'écu, dans lequel cette aigle se trouve
placée, est trop rétréci et ne comporte pas le dé-
ployement des ailes. Eb bien, le sculpteur auquel
ce travail était confié, tournait les grosses plumes
des ailes en dedans et trouvait encore moyen d'y
donner des contours gracieux. Les plumes, qui cou-
vrent le corps de l'aigle, sont traitées dans le vrai
style ornemental.
Nous ne donnons qu'un seul exemple d'une aigle
éployée du 14e siècle, n°16. Il nous serait facile
d y ajouter plusieurs autres, mais l'espace nous manque. Un coup d'oeil suffira pour découvrir à quels
égards il diffère de l'aigle éployée comme on la représente actuellement.
Les numéros 17 à 20 font voir les trois grands changements
de forme que les casques ont subi. Dans chacune
de ces grandes divisions la mode introduisit de nombreuses subdivisions, auxquelles nous ne pouvons
nous arrêter. Dans les fig. 21 et 22, on voit le plus
ancien type de casque que l'on rencontre sur les
armes, mais ce type n'a guères duré.
La fig. 17 présente une des formes les plus anciennes.
Le cimier de ce casque est un vol comme il était
d'usage à la même époque et qui semble formé de
deux planchettes d'un quart de cercle, dans le bord
desquels des plumes ont été introduites.
Le casque suivant, n°18, date d'une époque postérieure et s'appelait casque des joutes (en allemand
Stechhelm); le cimier, consistant en deux proboscides,
est remarquable par leur crête à angles saillants, que
l'on ornait souvent de boules, de plumes, etc. Nous
avons ajouté la fig. 19, représentant également un
casque des joutes, comme un nouvel exemple de la
liberté intelligente avec laquelle les artistes du moyen-âge traitaient les matières héraldiques. C'est le
casque d'un duc de Clèves, de l'an 1511, qui portait
en cimier une tête de boeuf. L'artiste s'aperçut que
le museau se conformait à la partie saillante du
casque; il vidait (au figuré) la tête de boeuf, la ti-
rait sur le casque, entourait les cornes d'une cou-
ronne et laissait pendre la peau en guise de lam-
brequins.
Enfin, au 16e siècle on donnait une forme ronde au
casque, pratiquait une ouverture sur le devant et y
mit des grilles, fig. 20. C'est ce dernier type qui,
avec nombre de modifications, s'est maintenu jusqu'à
nos jours.
Les fig. 21 et 22, représentant les armes des familles
de Helfenstein et de Leiningen (Linange), sont empruntées
au rouleau d'armes de Zurich, exécuté entre 1280 et 1325 et publié en chromolithographie en
1860. Dans la première de ces armes, n°21, le
meuble qui soutient l'éléphant, est un tertre à quatre coupeaux, et le cimier consiste en deux queues
de paon brochantes l'une sur l'autre. Le n°22 mérite l'attention par son cimier, l'écran, revêtu d'une
étoffe qui est tirée sur le casque en forme de capuchon.
Le rouleau d'armes de Constance, commencé en 1547,
continué dans les années postérieures et conservé à
la bibliothèque de la ville d'Ueberlingen, située sur
le lac de Constance, nous fournit dans la fig. 23 les
armes de la famille de Schwartz en Souabe, remarquables à cause du cimier, que l'on prendrait pour
une palette de peintre, mais qui est une des formes
très-anciennes d'une aile ou demi-vol.
Tout archéologue sait qu'une veine humoristique parcourait
le moyen-âge; les sculptures dans les anciennes abbayes et cathédrales en font foi. L'art
héraldique n'a pas été soustrait à cette influence,
comme il est prouvé par nos dernières flgures. Le n°24, pris dans le rouleau d'armes de Constance, nous
offre l'écu de la famille von Keutzlingen, en Souabe,
ayant pour cimier une tête de coq encapuchonnée,
dont le bec est traité de manière à en faire une figure grotesque. Les armes de la famille de Magugg,
en Souabe, fig. 25, empruntées au même rouleau,
portent en cimier un homme issant, s'ébouriffant les
cheveux et regardant d'un air béat ou bien stupide.
Les trois dernières figures de notre planche sont imitées de la feuille détachée de l'armorial hollandais
de 1542, dont il a été question plus haut. Les cimiers
des numéros 26 et 27 ont également un air grotesque ou
humoristique. Enfin, l'aigle du dernier écusson, n°28,
doit à son bec démesuré, qui semble grossi à dessein, un air narquois qui n est pas propre à la gent
volatile. Ces armes à l'aigle moqueuse portent le
nom de Morchan, qui est peut-être estropié et n'appartient pas à une famille des Pays-Bas. Les autres écussons sont anonymes.